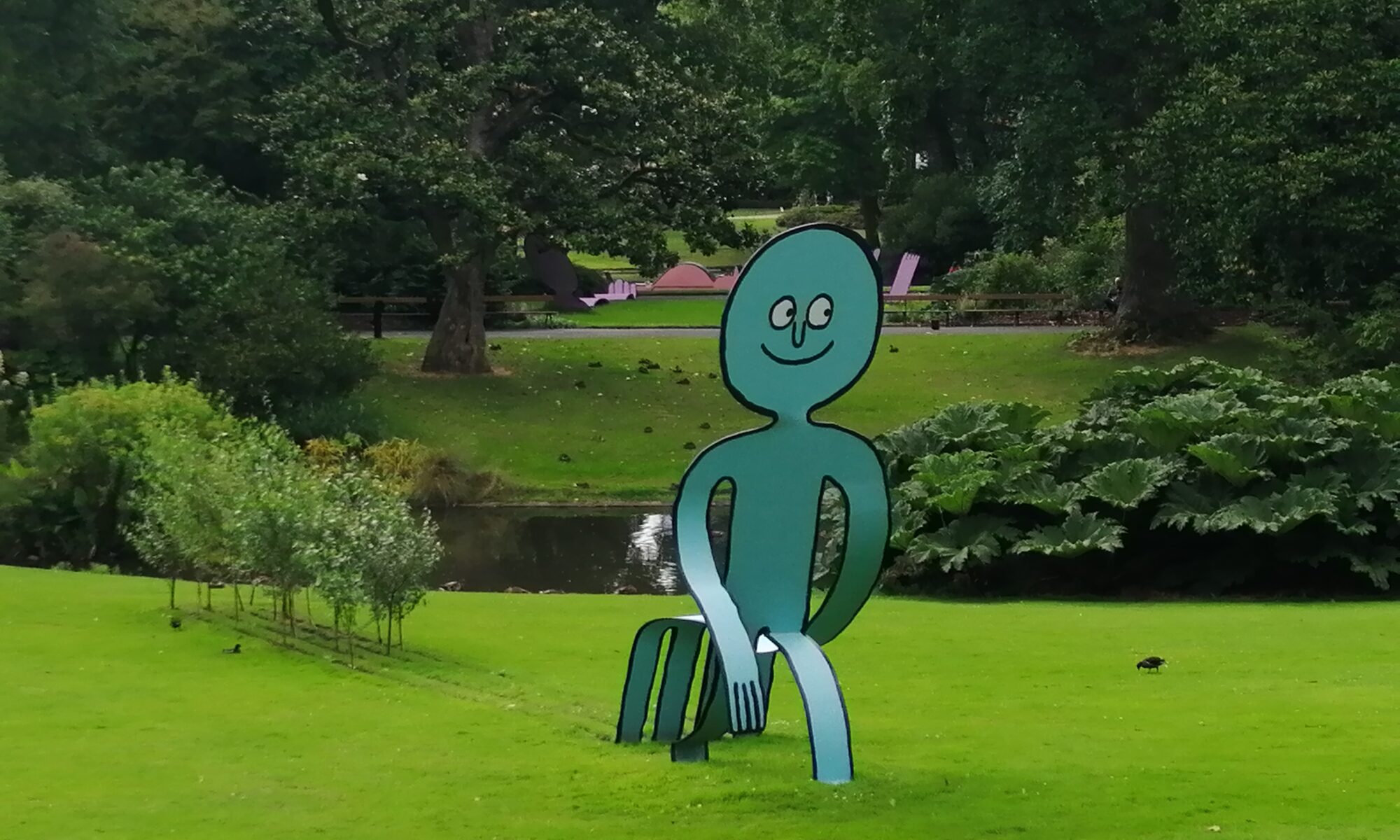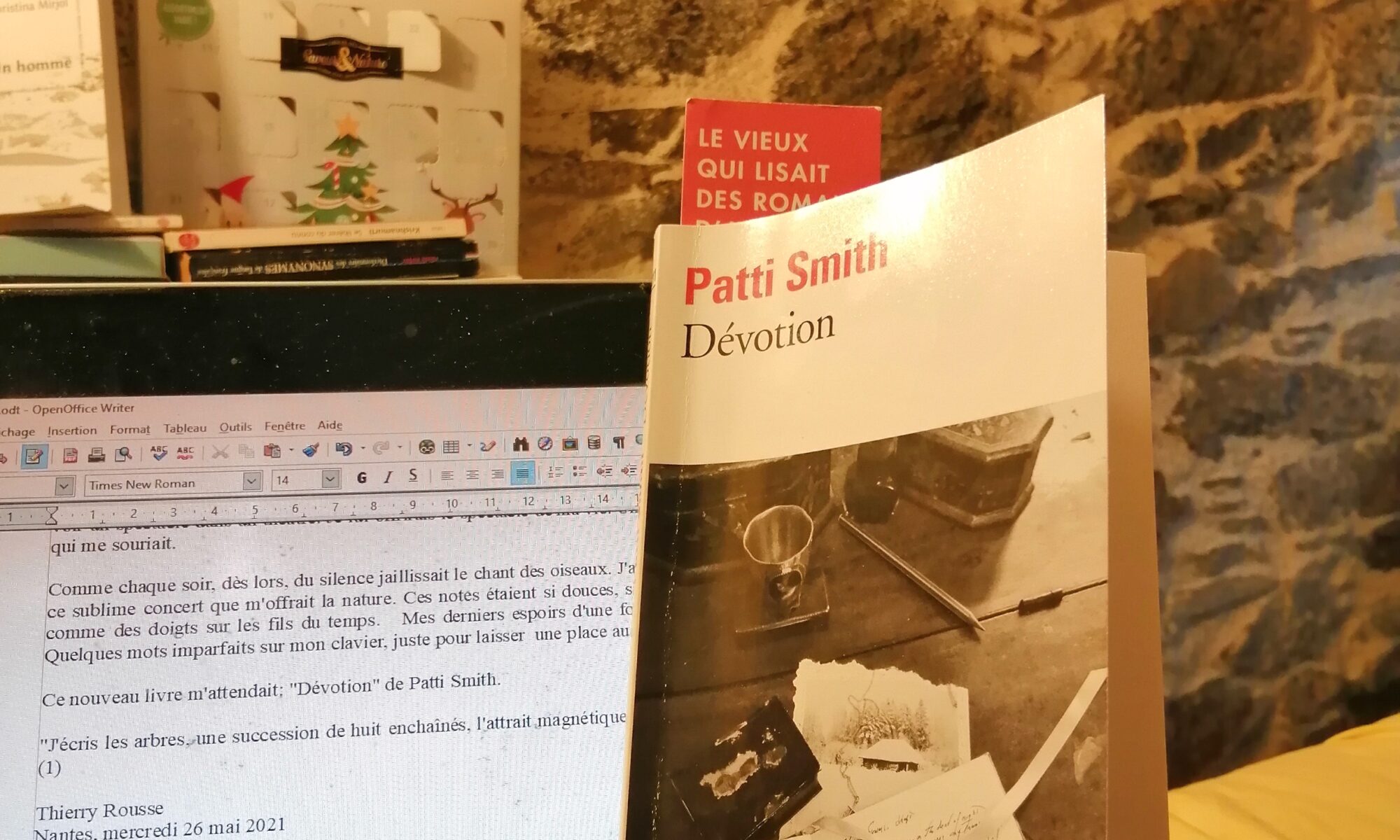Vendredi six août deux mille vingt et un. Je sortais en cette matinée de ma maison. Etrange sensation. Pour la première fois de ma vie, j’éprouvais la sensation de marcher dans un pays où la dictature venait d’être proclamée. Jusque là, la dictature d’une pensée unique était latente. Des lois passées en force habilement durant l’été pendant que mes pensées étaient occupées à se détendre. Là, mes pensées étaient concentrées sur le verdict des Sages. La sentence était tombée sans aucun dialogue. Pass obligatoire. Je me dirigeais vers mon cinquième test PCR, je crois. J’avais pu obtenir un rendez-vous à dix heures à la Manufacture. Oui, je savais ce qu’on allait me dire. « Tu ne sais pas ce que c’est la dictature, tu ne l’as pas connue, tu serais déjà en prison ». C’est vrai, jusqu’à présent, je n’étais pas arrêté pour mes paroles oumes pensées. Je serais juste arrêté si je n’avais pas mon pass. « Désolé, monsieur, vous ne pouvez pas entrer ». Juste cela et ce « cela » n’était pas anodin. Pour la première fois de ma vie, les Sages me dictaient ce que je devais imposer à mon corps. Cela représentait bien plus que le fait de devoir passer une ceinture de sécurité. Cette loi visait mon propre corps, pour mon bien et pour le bien des autres. Qu’en savais-je réellement si c’était pour mon bien et pour le bien des autres ?
J’arrivais à mon arrêt. Un panneau publicitaire m’informait : « Aujourd’hui, 3500 personnes vont mourir sur la route ». En dessous, je pouvais voir la photographie de Yohan Blake prêt à s’élancer sur la piste, champion olympique du quatre fois cent mètres, champion du monde. Quel était le rapport? Je prenais le bus. Il aurait pu écraser un hérisson et se piquer. Les nuages noirs menaçants, à l’horizon, étaient toujours présents, toujours aussi pesants. Parvenu à ma Duchesse, je glissais de mon Busway à mon Tram. « Manufacture ». Une voix bienveillante me rappelait mon devoir: « Avant de descendre, assurez-vous de ne rien avoir oublié à bord ». Qu’avais-je oublié à bord? Mon étrange sensation de ce matin? Mes soucis ? Mes amours ? Mes désirs et mes rêves de liberté ? Des blouses blanches de la tête aux pieds m’accueillaient. Où étais-je ? Dans une centrale nucléaire hautement radioactive ? « Mouchez-vous, lavez-vous les mains, baissez votre masque sous le nez, respirez, comptez un, deux, trois » et le tour était joué. La jolie blouse blanche avait introduit avec finesse sa coton-tige au fond de mon narine pour recueillir le subtil nectar. Je pouvais m’en aller habité de mon nouveau suspens. Serais-je positif ou négatif? Je positivais, vagabondant à travers les allées du jardin des Plantes. De drôles de bonhommes distrayaient mes pensées. un arroseur, un siesteur, un passeur, un ratisseur… Tout semblait paisible, hormis un hélicoptère qui ne cessait de tournoyer au-dessus de ma tête. Je me remettais de mon cauchemar. La France était encore un pays libre. Une lecture au coeur du jardin s’offrait à moi. Les « Heures d’été » sous un ciel automnal. Des barrières encerclaient la lectrice et le public. Je m’apprêtais à pénétrer dans cette clairière en plein air sous haute sécurité. » -Vous pouvez me le présenter? » me demandait une seconde charmante jeune femme dans une combinaison d’astronaute. « -Quoi? » lui répondais-je. « -Votre pass ! « . Cela paraissait déjà banal, une habitude, un réflexe. Je sortais un vieux pass de mon smartphone, le pass du mardi qui fit l’affaire. J’étais autorisé à entrer dans l’espace protégé d’un jardin écouter une lectrice. Quelle chance ! Je rendais grâce aux Sages pour leur bonté. Citoyen soumis à la nouvelle démocratie. Je n’en demeurais pas moins pensif et profondément mal à l’aise. J’écoutais des extraits de textes de Christian Bobin, de Wajdi Mouawad lus par la comédienne Romane Pénet, des textes qui évoquaient des souvenirs d’enfance, des textes qui pouvaient évoquer la liberté ou le désir de liberté dans l’espace d’un jardin, où, pour être autorisé à écouter ces textes, je devais me soumettre à l’obligation des Sages. La culture, logeait, dès lors, dans une belle cage à oiseaux. Le paradoxe était là. Je ne me sentais plus à ma place, plus en cohérence avec moi-même et le sens de tout « cela », de tous ces mots. J’attendais la fin.
Un soleil avait été brisé. L’arc-en-ciel le consolait. La résistance se formait. Je la rejoignais. Je sentais déjà les flèches des reproches me transpercer.
Thierry Rousse
Samedi 7 août 2021
« A la quête du bonheur »