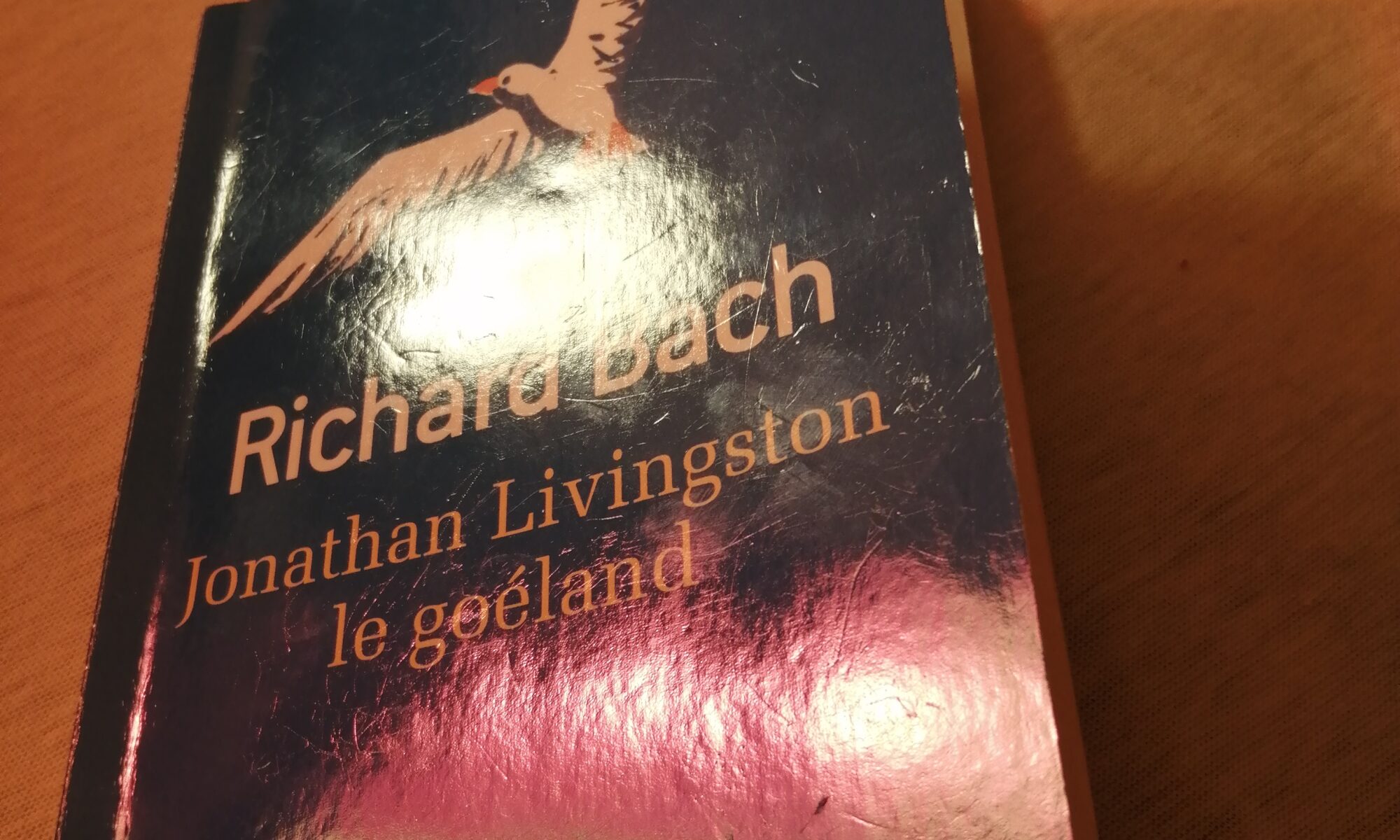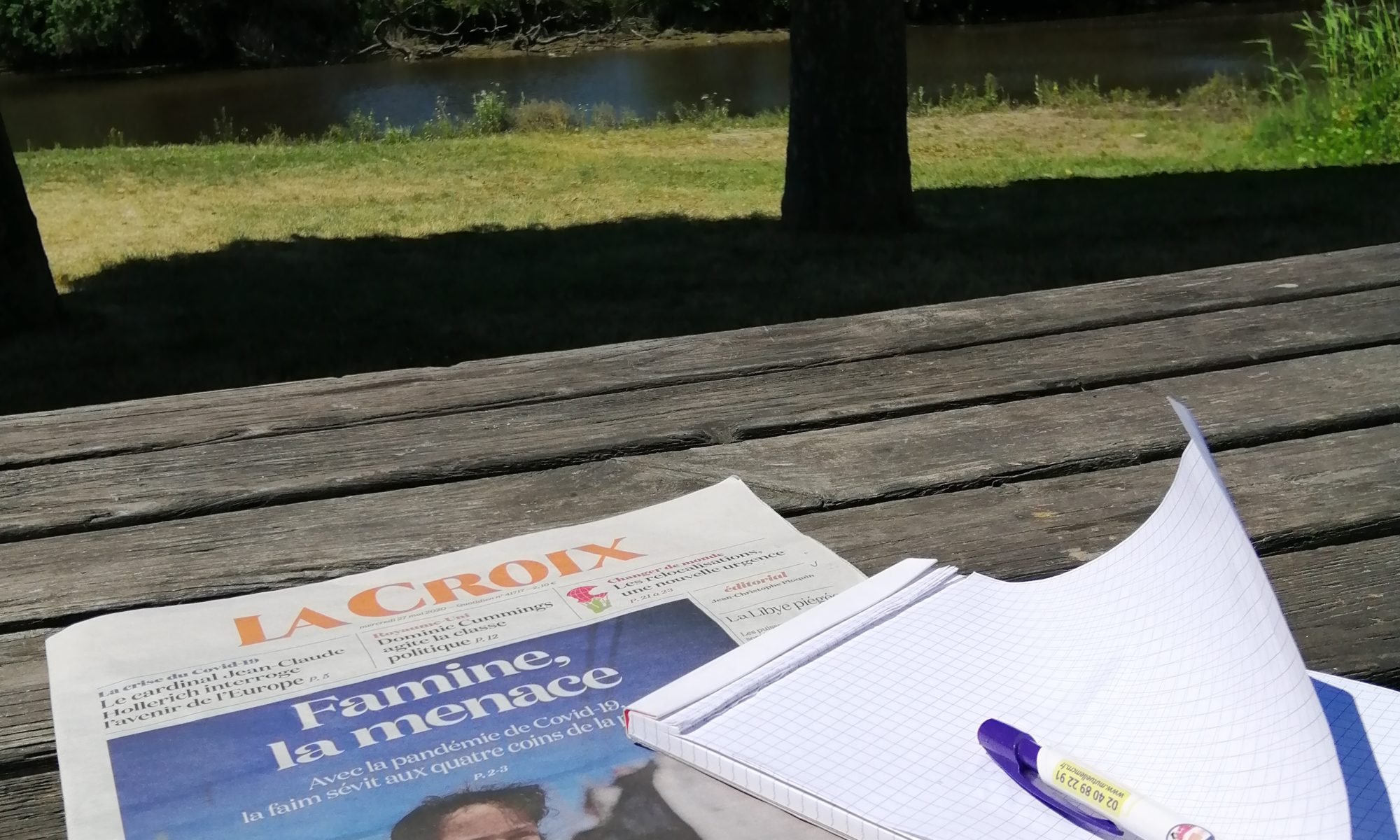Depuis hier soir, les projecteurs s’étaient tournés vers les Etats-Unis, c’était l’heure du grand match, un grand match qui n’en finissait pas de se jouer. On attendait les derniers bulletins de vote par la poste, ils pouvaient arriver jusqu’au 12 novembre. Des heures et des heures de dépouillement d’ici là. Le Roi Trompe annonçait déjà sa victoire, tout baveux qu’il était de sa soif de pouvoir. Joe la Force tranquille souriait. Pour tous les démocrates, c’est Joe qui avait gagné. Il était en tête, Joe, mais Trompe avait la grosse tête prêt à éjecter son adversaire par-dessus les cordes du ring en accusant les élections de truquées s’il perdait. « Perdre », un mot que Trompe avait rayé de son dictionnaire, il ne pouvait que gagner, Trompe ne se trompait jamais, il s’autoproclamait vainqueur, balayant sur son tapis rouge toute opposition. La terre des ancêtres était loin, oubliée.
On en venait aussi à oublier les autres actualités, le Covid, 426 morts en 24 heures, et les attentats. Le Lieutenant Héron était furieux : en son absence, les députés avaient voté la fin du confinement au 15 décembre. Au 15 décembre, tout le monde serait guéri et les festivités pourraient reprendre. J’avais rendez-vous ce matin à 9 heures à la Maison de l’Emploi, une Maison de l’Emploi, quelle chance ! Cela n’avait peut-être rien à voir. Je faisais état de mes recherches et candidatures en cours. A 11h20, un autre rendez-vous m’attendait dans un Cabinet médical au coeur du Grand Centre Commercial Beaulieu. L’accueil de la secrétaire était plutôt froid à mon goût. Avait-elle mal dormi cette nuit ? Avait-elle trop regardé le match ? S’était-elle disputée avec son copain Trompiste républicain ? Ou tout simplement,était-elle stressée par son travail ? Un beau canapé bleu m’attendait pour détendre mes jambes et attendre mon tour. «- Monsieur Rousse ? – Lui-même ! ». Une charmante assistante masquée, coiffée d’un tissu jaune agrémenté de motifs indescriptibles m’introduisit dans un long couloir. « Je vous emmène chez le docteur ». Quel bonheur d’être ainsi mené chez le docteur ! Tout en délicatesse. La douceur pouvait changer le cours d’une journée. J’accordais beaucoup d’importance au premier contact, à cet instant de la salutation : prendre le temps de regarder mon interlocuteur, le saluer, lui sourire. Un médecin asiatique m’accueillait chaleureusement. Aussitôt, je me sentais à l’aise, détendu, en territoire connu. « J’ai examiné votre radio » , me dit-il, « trois dents en bas, et deux en haut, à droite, pour commencer. A gauche, ça peut attendre .- Si vous le dites, Docteur, la gauche, elle peut attendre… – Marie vous enverra le devis » . J’étais sauvé, Marie la Douce au tissu jaune indescriptible m’enverrait le devis. Je souriais en fermant la bouche. Des dents manquantes, ce n’était pas du meilleur goût. Il y avait comme quelque chose qui manquait. Tout de suite, ça faisait pauvre, le genre du pauvre homme qui avait raté sa vie, celui qui n’avait pas pu se racheter ses dents. « – Vous allez bien, rien à signaler ? – Je devais faire un bilan de santé ce lundi, mais vous comprenez, avec le virus, le bilan de santé a été annulé ». Il m’était donc impossible de savoir si j’étais en parfaite santé. En cette époque de crise de sanitaire, nul ne pouvait savoir s’il était malade. On devait attendre pour un bilan, attendre pour être soigné, attendre pour être opéré. Attendre tranquillement, attendre quoi ? Attendre qui ? – Et comment c’est fabriqué cette dent artificielle ? Je vous enfonce un bout de fer dans la gencive, et sur le bout de fer, je colle de la céramique pour faire joli ». Bien sûr, le jeune docteur s’exprimait dans un langage plus soutenu, plus raffiné, il avait des dents, le docteur ! « – Et le tarif ? … ». Une feuille m’était présentée avec plusieurs chiffres. Je fis un rapide calcul, au-moins 5600 euros, cinq implants, 1000 euros l’implant. Marie se renseignerait auprès de ma Mutuelle. Marie était si gentille, mais, j’étais plutôt du genre « homme fidèle ». Il n’existait qu’une seule femme dans ma vie, Emma. Je remerciais Marie et me rhabillais. Le tapis roulant me ramenait vers le ciel bleu. A la sortie du Centre Commercial Beaulieu, un distributeur de gels et de masques se rappelait à mon bon souvenir. « Sortez couverts ! ». Le temps d’acheter un pain, de monter dans ma vieille voiture bleue délavée qui sentait la menthe pour éviter une pandémie dans le bus, je rentrais au chaud, enfin, chez Mémé Zanine. Je fis mes comptes. Quel serait mon budget du mois de novembre ? Plus aucun bonbon dans mon joli petit cochon rose. Je devais percer un nouveau trou dans ma ceinture. La santé avait pris son rang dans les grands centres commerciaux. J’achetais ma santé en fonction de mes moyens. Si je n’avais pas de moyens pour l’acheter, ce qui était, à l’heure actuelle, mon cas, je restais sans dent et je souriais la bouche fermée. Après le budget, c’était le tour de l’actualisation de mon CV. Mes journées étaient formidables. J’avais décidé de faire avec amour chaque petite chose et cela changeait tout. Tout devenait aventure. « La vie était belle ! ». A seize heures, c’était l’heure de ma pause goûter. Je savourais le bon air dans le jardin sous un ciel bleu de toute beauté. Tout en marchant, je téléphonais à mon amie créatrice de jardins miniatures. « Devine quoi ? Hier, j’ai créé mon premier jardin miniature ! ». Puis on parlait de Trompe, de Joe, du confinement, de l’emploi… Au bout du compte, l’avenir était aux jardins miniatures. Je me demandais ce que Bob Dylan pouvait bien penser de Trompe. Je n’en savais rien. On racontait que les pauvres votaient pour Trompe. Je n’y comprenais plus rien, plus grand chose au monde. J’avais rejoint ma Mémé Zanine. C’était l’heure du jazz sur Fip. L’heure de ces belles soirées d’été, un verre à la main, un pas de danse, une sourire, la bouche fermée. Et la réponse ? Quelle était la réponse ? Elle soufflait dans le vent. Je n’avais jamais compris ces paroles : « The answer, my friend, is blowin’in the wind ». Je cherchais une réponse dans le vent et je ne voyais rien. Le vent était invisible, il se sentait, il se vivait. Le vent nous poussait comme il pouvait nous empêcher d’avancer. Il pouvait nous élever comme nous renverser. Le vent apportait les nuages noirs comme il les chassait. Le vent était imprévisible. On le redoutait comme on pouvait l’espérer. Le drapeau flottait au vent et aujourd’hui, il n’y avait pas de vent. Attendre, attendre le dépouillement, la dernière lettre pour savoir, savoir de quoi l’avenir sera fait. Je m’appliquais à écrire une lettre, la plus belle lettre que je pouvais à Emma… Dylan jouait de son harmonica au coin du feu et m’offrait son prix Nobel : « How many roads must a man walk down, Combien de routes un homme doit-il parcourir Before you call him a man ? Avant que vous ne l’appeliez un homme ? Yes, ‘n’ how many seas must a white dove sail Oui, et combien de mers la colombe doit-elle traverser Before she sleeps in the sand ? Avant de s’endormir sur le sable ? Yes, ‘n’ how many times must the cannon balls fly Oui, et combien de fois doivent tonner les canons Before they’re forever banned ? Avant d’être interdits pour toujours ? ».
Le vent soufflait et soufflait, dans un sens, dans un autre, ce prix Nobel entre mes mains. L’harmonica continuait. Les flammes grandissaient.
« How many years can a mountain exist Combien d’années une montagne peut-elle exister Before it’s washed to the sea ? Avant d’être engloutie par la mer ? Yes, ‘n’ how many years can some people exist Oui, et combien d’années doivent exister certains peuples Before they’re allowed to be free ? Avant qu’il leur soit permis d’être libres ?
Yes, ‘n’ how many times can a man turn his head, Oui, et combien de fois un homme peut-il tourner la tête Pretending he just doesn’t see ? En prétendant qu’il ne voit rien ? ».
Ce feu nous réchauffait comme il nous embrasait.
« How many times must a man look up Combien de fois un homme doit-il regarder en l’air
Before he can see the sky ? Avant de voir le ciel ? Yes, ‘n’ how many ears must one man have Oui, et combien d’oreilles doit avoir un seul homme Before he can hear people cry ?
Avant de pouvoir entendre pleurer les gens ? Yes, ‘n’ how many deaths will it take till he knows Oui, et combien faut-il de morts pour qu’il comprenne That too many people have died ? Que beaucoup trop de gens sont morts ? » (*)
Je levais les yeux, je contemplais le ciel bleu… Combien de temps encore… C’était l’heure… Ce n’était pas l’heure… Y-avait-il assez de morts ?… Pas encore ? … Le vent avait cessé de souffler, personne ne l’avait écouté. Je t’entendais pleurer. La montagne était noyée. Flottaient un dernier drapeau, une colombe perdue. Les pauvres, les affamés, les malades, les sans-dents traînaient leur boulet au pied. Les canons résonnaient sur les vestiges de l’amour. Je rêvais de m’endormir près de toi, Emma, sur un sable doré d’étoiles mais le match n’était pas fini. Trompe était jaloux de mon Nobel. La réponse était dans le vent…
Thierry Rousse,
Nantes,
Mercredi 4 novembre 2020.
(*)Bob Dylan, « Blowin’in the Wind »