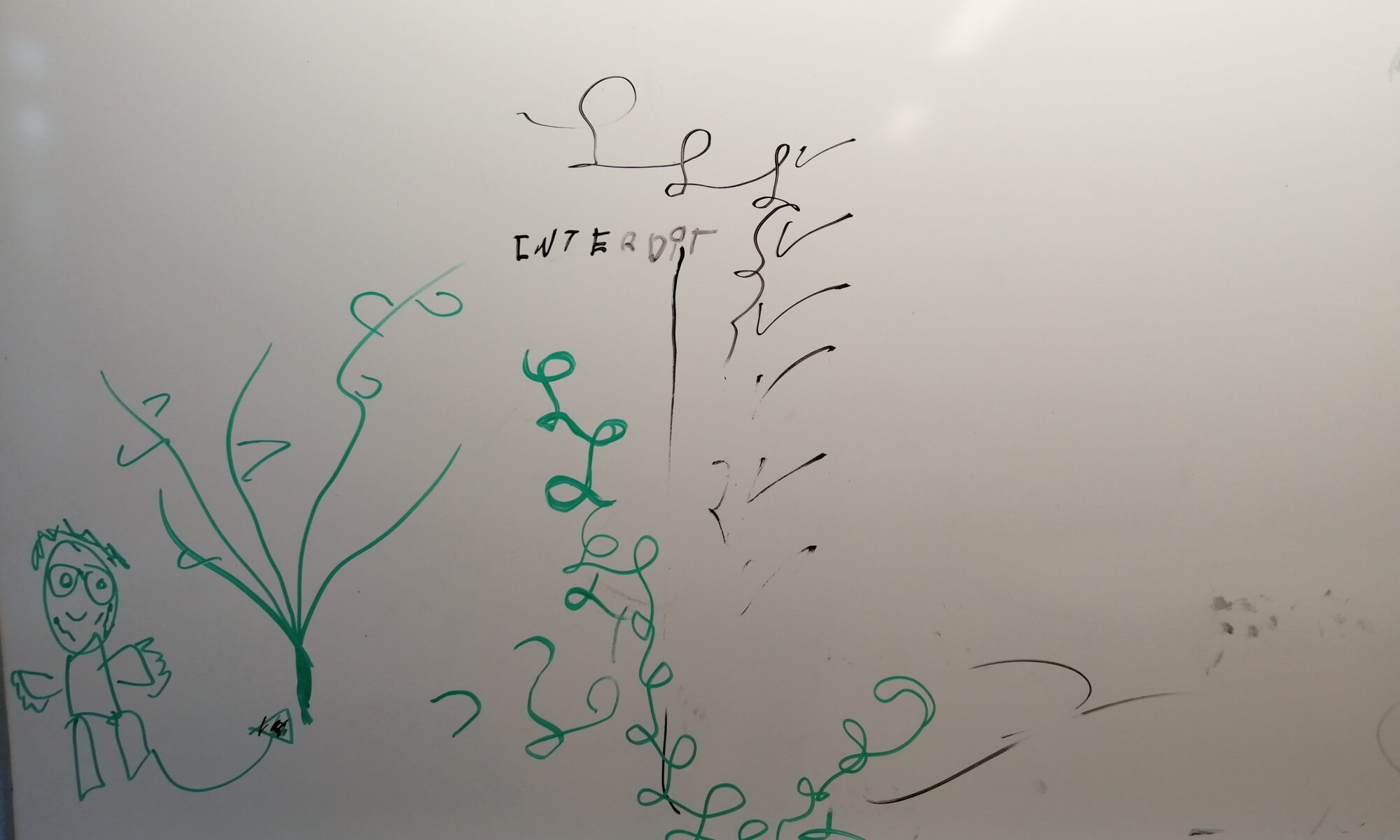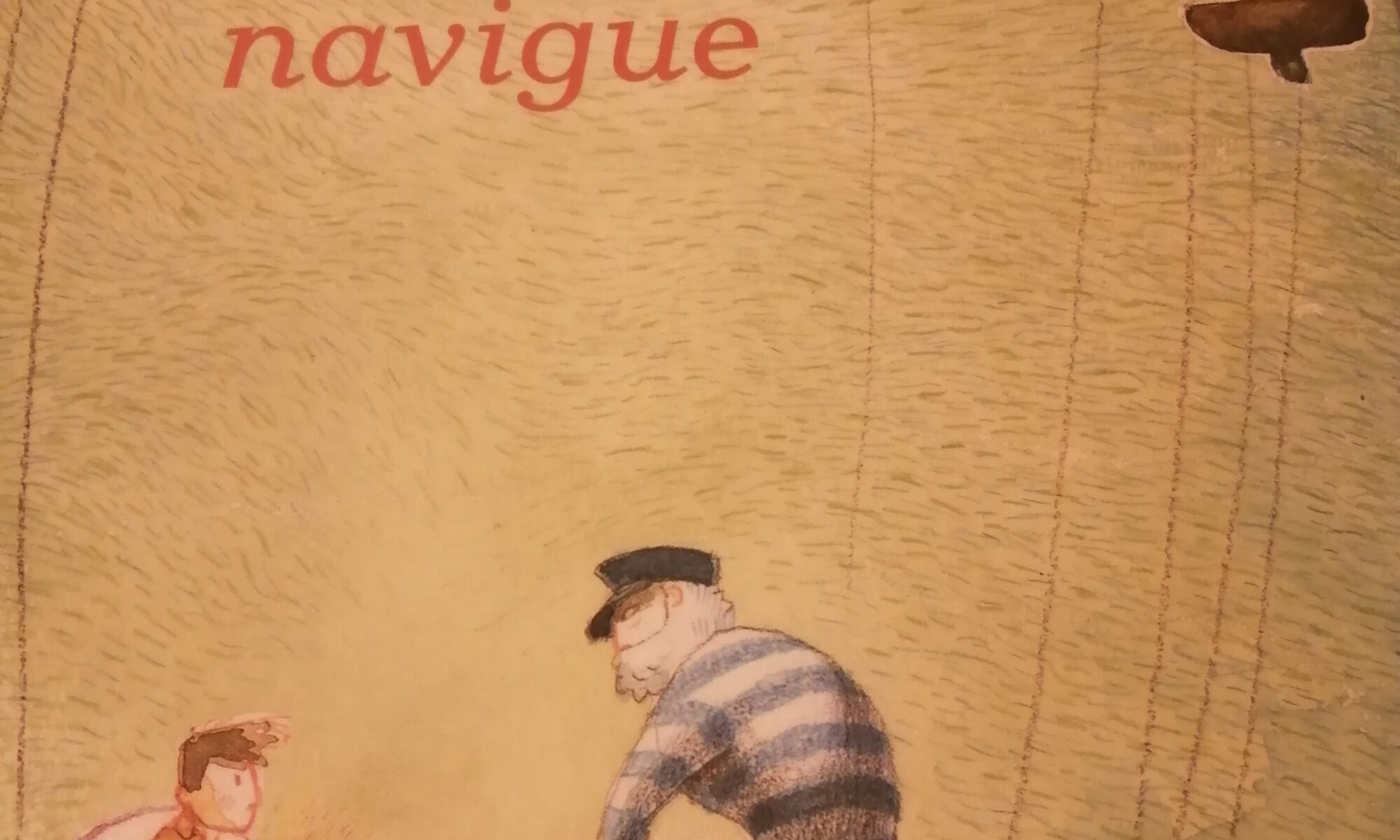La période n’avait jamais aussi contradictoire, floue à mes yeux. Les chiffres tantôt paraissaient stagner. Ils indiquaient que nous n’avions aucune raison de nous alarmer. Des lits de réanimation étaient encore disponibles dans les hôpitaux. Tantôt les chiffres étaient annoncés comme inquiétants avec l’arrivée du Mutant anglais sur notre territoire. Le Grand Chef voulait à tout prix éviter un troisième confinement qui serait fatal à notre économie et au moral des françaises et français, notamment des plus jeunes ne voyant plus le bout du tunnel. Une jeunesse sacrifiée. Vingt ans et rien d’une vie de vingt ans. Tous nos efforts devaient être concentrées pour éviter ce troisième confinement. La menace, certes, planait. Devais-je développer des stratégies afin de vivre dans l’instant présent et m’en réjouir, ou, me réfugier dans les doux moments du passé pour me projeter vers l’avenir dans l’espérance de retrouver demain le monde d’hier que je connaissais ?
La mission de Guide après le premier confinement qu’Emma m’avait confiée me procurait tellement de joies. Je me sentais, enfin, utile, reconnu, apprécié. Je me réjouissais à l’idée de partager mes découvertes de la ville de Nantes. Tous mes instants de solitude prenaient sens dès lors que je pouvais en cueillir les fruits et les faire goûter.
Dans ma besace, il y avait la plupart des jardins de Nantes : la Crapaudine, le Jardin des Plantes, le Jardin extraordinaire, le Parc de la Gaudinière, le Parc de Procé, Le Grand Blottereau, L’île de Versailles, Le Parc des Oblates et la Roseraie de la Beaujoire.
Dans ma besace, il y avait des balades bucoliques sur les bords de la Sèvre, de l’Erdre, de la Loire et du Cens.
Dans ma besace, il y avait des cafés culturels comme Le Baroudeur et ses matchs d’improvisations théâtrales si drôles; Le Rouge Mécanique et ses soirées de slams ou encore, ses Amuse-Gueule clownesques ; Le Live Bar et ses concerts rock ou de musiques du monde.
Dans ma besace, il y avait des cinémas d’art et d’essai, Le Katorza, Le Cinématographe, et leurs nombreux festivals : « Les trois continents », « Le cinéma britannique », « Le cinéma allemand », « Le cinéma espagnol »…
Dans ma besace, il y avait presque tous les théâtres nantais, leurs spectacles, leurs festivals, leurs rencontres littéraires, philosophiques, sociétales, artistiques : Le Lieu Unique, le Grand T, Le Théâtre Universitaire, Le Studio-Théâtre, Le Conservatoire de Danse, Le T.N.T., Le Cyclop, La Ruche, le Théâtre de Belleville. le Théâtre Francine Vasse, le Poche-Graslin. Il me restait à pousser les portes du Théâtre de Jeanne, de La Compagnie du Café-Théâtre, du Théâtre 100 Noms et de l’Opéra Graslin.
Dans ma besace, il y avait des musées, celui du Château de notre Duchesse Anne, celui des Beaux-Arts, celui de Jules Vernes, le Musée d’histoires naturelles, Les Machines de l’Ile.
Dans ma besace, il y avait aussi des restaurants atypiques ou ornés de jolis décors, des restaurants chaleureux aux tarifs accessibles. Dans ce domaine gastronomique, j’en étais qu’à mes premiers pas. j’avançais au rythme de mes ressources : le Bar-Restaurant du Lieu Unique, Le « Coup Fourré », Les « Gourmandises du Liban », « Le Couscoussier », « Chez Rémi », la Brasserie « La Prairie », « La Grande Barge », les crêpes et galettes artisanales du « Barapom' » ….
Mes ardeurs de Guide nantais furent, tristement, entravées par les restrictions du Grand Chef. Notre liberté n’était que conditionnelle. La vie n’avait pu que reprendre partiellement vers la fin du printemps 2020, jusqu’à disparaître totalement, de nouveau, au mois de novembre 2021 suite à un second confinement. Nul ne pouvait connaître le jour du retour à la « vie », cette « vie » que j’aimais tant transmettre et partager.
La parenthèse de l’été avait permis de re-goûter, du bout des lèvres, à la vie culturelle nantaise et sa gastronomie : Transfert et Le Quai des Chaps proposaient des spectacles, des concerts et des soirées festives. Danser, s’amuser étaient de nouveau permis. Les restaurants ouvraient sous haute sécurité. J’appréciais doublement cette galette et cette glace à La crêperie rustique « Sainte-Croix » au coeur du quartier historique du Bouffay. Une sensation de revivre avant que les portes du plaisir et de la culture, une nouvelle fois, ne fussent contraintes de fermer.
Cette parenthèse close, que me restait-il à offrir à Emma ? Les balades à travers les jardins et le long des fleuves ? Le cercle se rétrécissait, l’hiver, au soleil couchant. Dans les rues, les corbeaux criaient : « Couvre-feu ! ». « La vie reprendrait, Emma ! ». Mes promesses finissaient par la lasser et l’agacer. Il me restait à accueillir l’instant présent. Nantes reconnue pour le dynamisme de sa vie culturelle et l’effervescence de sa vie nocturne n’était plus Nantes. La ville de l’Eléphant n’était plus qu’une métropole de travail et de promenades, heureusement, sauvegardées.
Je cherchais à élargir mon cercle en devenant le Guide du Vignoble nantais. Je songeais également à parcourir les rues de ma ville et en découvrir leur histoire. Certes, mon cher Eléphant me manquait, mais, tout ce que j’apprendrais de sa cité et de ses contrées environnantes, je pourrais, un jour, le partager à Emma. De nouvelles perspectives s’offraient à mes yeux. Ma vie pouvait encore avoir un sens, pourvu que je fusse protégé par mon Ange-Gardien, à l’abri du Mutant !
Emma, au milieu de sa place, sur son piédestal, me regardait partir avec mon sac à dos, mon bonnet et mes nouvelles chaussures de marche imperméables. Je sortais, motivé, sous les flocons de neige à cueillir leurs étoiles. Pèlerin m’allait bien. Je m’exerçais à ralentir mes pas pour saisir l’essentiel d’une vie. Les personnages interprétés dans le film « Un homme pressé » m’avaient tant touché. Fabrice Luchini jouait un homme d’affaires. Alain était tant affairé à ses affaires qu’il ne lui restait qu’à peine dix minutes pour s’entretenir avec sa fille, quand, un accident cérébral vint bouleverser ses habitudes. Alain allait, enfin, prendre le temps de vivre, de se ressourcer, d’écouter et d’aimer. Sa fille le retrouverait, et, tous deux marcheraient, dès lors, côté à côte.
L’histoire était belle, et, je me disais: « Au-moins, si cette catastrophe peut servir à ça… ».
Un pas de côté pour regarder autrement la vie,
Sur le tableau de l’école, une enfant l’avait dessiné…
Thierry Rousse
Nantes, vendredi 12 février 2021
« A la quête du bonheur »